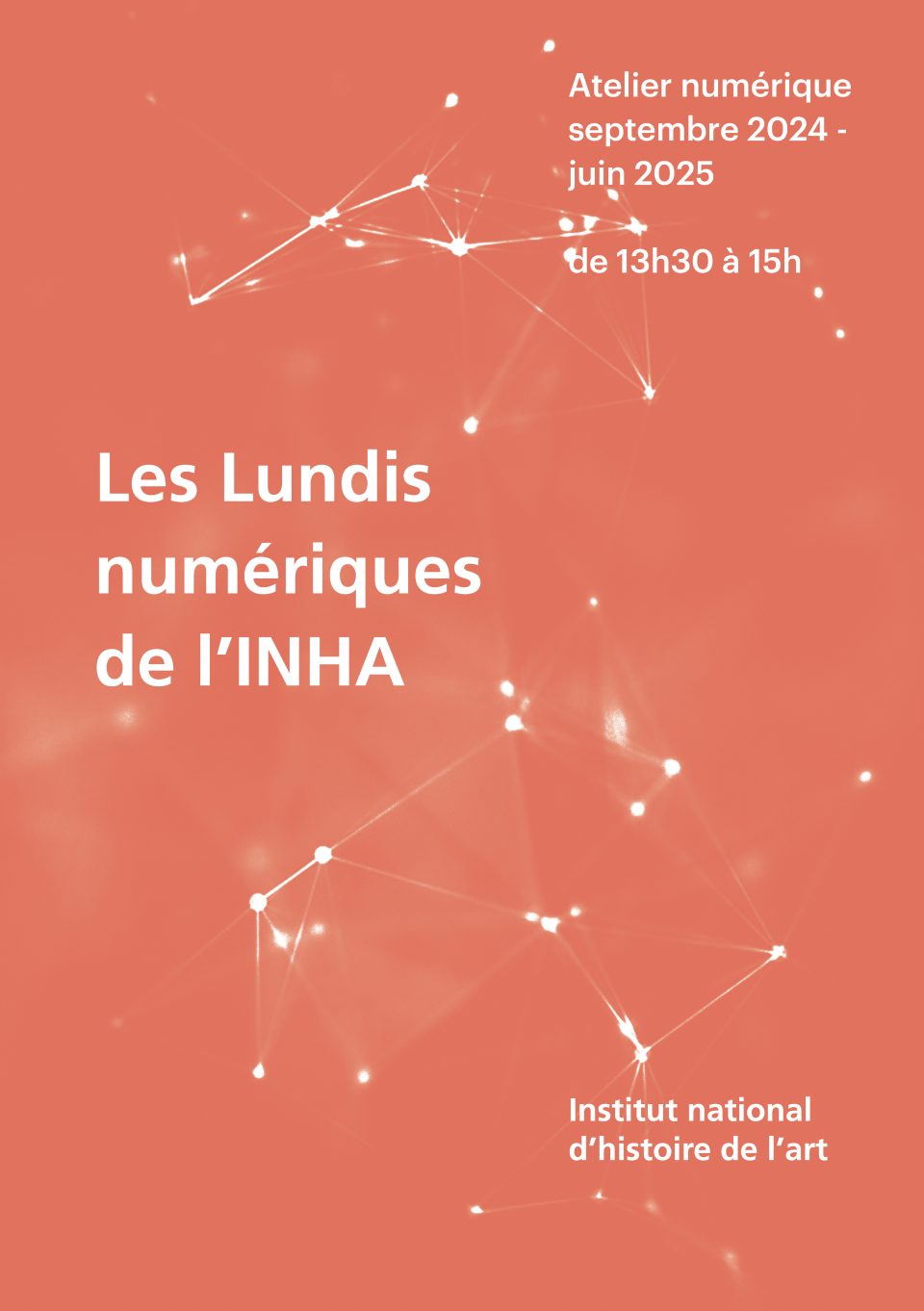Lieu
Date
Heure
INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari
11 mars
16h-17h
Loin d’être l’apanage des peintres, l’or s’inscrit à la confluence de différents métiers à la période moderne. Sous l’angle d’une histoire sociale de l’art, cette séance aborde les relations entre les acteurs comme entre les supports de la création. En ouverture, Audrey Nassieu Maupas, maître de conférences à l’EPHE, présentera les artisans et les métiers de l’or à Paris au XVIe siècle d’après les sources documentaires, tandis que Julien Lugand, maître de conférences à l’université de Perpignan, reviendra sur les liens entre doreurs et peintres au XVIIe siècle. En contrepoint, Elliot Adam et Romain Thomas interrogeront quelques représentations picturales d’artefacts en or rendus par l’usage de dorure.
Intervenants et intervenante
Julien Lugand (université de Perpignan) et Audrey Nassieu Maupas (EPHE), en dialogue avec Elliot Adam (INHA) et Romain Thomas (INHA / université Paris Nanterre)
À propos du séminaire du programme de recherche AORUM « Pour une histoire matérielle de l’art. L’or et ses usages dans la peinture de la première modernité »
De l’or chez Raphaël, Dürer, mais aussi Carrache, Vermeer et Rembrandt ? À rebours d’une histoire de l’art « aveugle » à sa présence, le programme AORUM éclaire les usages de ce métal par les peintres européens des XVIe et XVIIe siècles. Comment l’interprétation de leurs œuvres s’enrichit-elle de la prise en compte de l’or comme un matériau pictural dont la relation à la lumière, par son éclat métallique, le distingue des pigments habituels ? Les séances de ce séminaire interdisciplinaire (histoire de l’art, optique, sciences de la conservation, humanités numériques) ouvrent un dialogue entre les travaux de spécialistes invités et les premiers résultats du programme.
En partenariat avec le laboratoire équipes traitement de l’information et systèmes – ETIS (UMR 8051, CNRS/ CY Cergy Paris Université / ENSEA), l’unité de recherche histoire des arts et des représentations – HAR (université Paris Nanterre) et le laboratoire d’archéologie moléculaire et structurale – LAMS (UMR 8220, CNRS / Sorbonne Université) dans le cadre du projet ANR-22-CE27-0010.
Comité scientifique
Elliot Adam (INHA), Christine Andraud (Centre de recherche sur la conservation – CRC, CNRS / MNHN), Vincent Delieuvin (musée du Louvre), Sven Dupré (université d’Utrecht), Mercedes Gomez-Ferrer Lozano (université de Valence, Espagne), Ann-Sophie Lehmann (université de Groningue), Sandra Rossi (Opificio delle pietre dure, Florence), Heike Stege (institut Doerner, Munich), Romain Thomas (INHA / université Paris Nanterre), Laurence de Viguerie (laboratoire d’archéologie moléculaire et structurale – LAMS, CNRS / Sorbonne Université), Dan Vodislav (équipe traitement de l’information et systèmes – ETIS, CNRS / CY Cergy Paris Université), Rebecca Zorach (université Northwestern, Chicago)
Comité d’organisation
Elliot Adam (INHA), Romain Thomas (INHA / université Paris Nanterre)